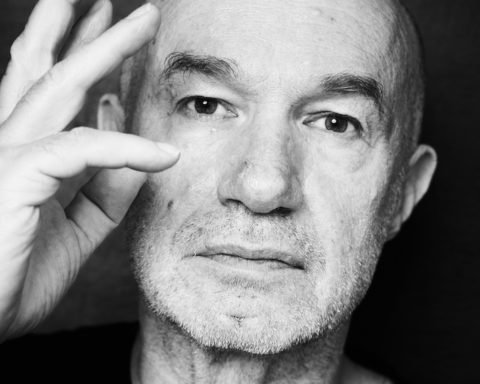Depuis dix jours, je ne dis rien. Je vois fleurir partout les paroles de mes amis artistes qui face à ce que nous traversons de terrible et d’historique ont besoin d’exprimer des visions. Je m’en sens incapable. Les évènements vont si vite, le monde est hors de ses gonds, des flots de métamorphoses nous submergent plus vite que nous ne pouvons les penser. Nous n’avons plus de prise. Nous ne sommes plus les maîtres du temps.
A part une logorrhée qui décrirait les images sans comprendre les agencements, je ne sais pas bien ce qui pourrait sortir de ma bouche. Il se passe quelque chose de plus grand que nous. Une idée que nous ne comprenons pas bien révèle nos impuissances et active notre imaginaire. Nous sommes sidérés. Sidération « action funeste des astres « , l’anéantissement subit des forces vitales, l’arrêt de la respiration, un état de mort de mort apparente. Les astres, de là où ils sont accrochés dans le ciel, nous frappent de coups invisibles, sans nous toucher. Nous voyons les effets, nous ne voyons pas l’ennemi. La terreur, terror, peurde l’homme face au courroux divin.
Contempler sans cesse à travers les médias et les écrans notre inquiétude, son fantôme, ses effets, ne nous aide pas à comprendre mieux. Nous nous abîmons dans le roulis du même, des mêmes injonctions, des mêmes images, de voir s’amonceler les chiffres. L’image de la terreur prend toute la place, nous sommes captifs, dans un état d’arrêt où on ne souffre plus, comme si l’émotion extrême menait à son inverse, l’apathie, l’aphasie.
Ou bien, et c’est encore plus étrange, un autre inversé : l’extase, une jouissance inconsciente. Une sorte d’excitation étrange de la catastrophe, de l’exceptionnel titille : que quelque chose se passe qui viennent nous balayer, nous rappeler à notre petitesse. Une fascination morbide pour la courbe qui monte, comme lorsque la crue de la Seine était de plus en plus haute et que les vidéos et les photographies pullulaient, que l’on allait en pèlerinage voir où le rivage avait été mangé. Un secret désir de mort et d’anéantissement bien caché au fond de nos sociétés de la surpuissance. L’attente morbide du décompte des morts à 20h. Et puis, les tout aussi étranges plaisirs de l’injonction autoritaire. De se regarder bien faire – les gestes barrière. Regarder les autres faire moins bien. Une maman voit avec effroi sa petite fille frôler un étranger sur sa trottinette et lui dit en lui serrant le poignet : « si tu respectes la règle, il ne t’arrivera rien ». La terreur, avec tous ses paradoxes et son petit arsenal du regard.
Je pense au mythe de la Méduse. On ne peut la regarder sans être changé en pierre. Elle fige la vie, le mouvement, la pensée en un instantané. Elle capture le sujet dans un impensable. Un monstre ambigu, à la fois séduisant et désirable dans certaines versions du mythe, et horrible, révulsant dans d’autres, cheveux hérissés de serpents, barbe et corps de femme, corps animal… une surface sur laquelle les imaginaires s’épanchent sans pouvoir véritablement s’accorder entre eux, décrite seulement par les poètes qui la rêvent. Pas de témoin objectif de son apparence.
Par la ruse, Persée parvient à l’affronter grâce au miroir. Le miroir est brandi, la bête voit son reflet, se terrasse elle-même. Ou bien, dans une autre version : Persée regarde le reflet de Méduse dans son bouclier poli, son pouvoir est désactivé dans l’image – Persée ajuste son coup et lui tranche la tête. Le héros s’approprie alors le pouvoir de la Méduse. Même morte, la tête coupée continue de pétrifier, Persée la met dans sa sacoche et s’en sert pour sa guerre.
Affaire d’image, d’imaginaire. D’imaginaire qui sauve et d’imaginaire qui tue.
Aujourd’hui, Méduse n’est pas la pandémie, mais la terreur de la pandémie. Toute cette impuissance dans laquelle nous place l’idée d’un danger invisible qui se propage. Cette peur nous devons trouver un biais pour la nommer, et la penser rationnellement, en contrôler l’émotion, si nous ne voulons pas en être des victimes dont on a coupé la langue et les neurones.
Qui se proclamera, à la fin, comme héros ? Qui récupérera la tête de Méduse et s’en servira pour contrôler, faire taire, figer les mouvements ? Qui seront les boucs émissaires de cette peur ? Comment aurons-nous été modifiés ?
Dans ces évènements, je me méfie toujours de la récupération. Le pouvoir aime à voir dans la peur des maux qui nous frappent l’occasion d’une reprise de contrôle sur l’imaginaire collectif. Ce fut le cas après les attentats. Dans une peur collective nous sommes un corps qui fait un tout. Victimes réelles dans leur chair et spectateurs liés dans une même expérience.
La peur est censée nous enseigner le prix de certaines valeurs. Que celle de l’épidémie nous apprenne à chérir la solidarité, les services publics, la culture qui nous empêche de devenir fou dans nos maisons, la présence à l’autre et non le repli sur soi, la phobie, le tout virtuel, encore plus de pressurisation pour rattraper le temps perdu de l’économie.
Que ferons-nous des images et des imaginaires produits par la pandémie ? Seront-ils des instruments dont nous nous saisirons pour nous libérer ou des instruments qui nous cloitreront un peu plus dans nos solitudes et nos angoisses ?
Privée de théâtre, de corps et de présence, je n’ai pas d’arme de résistance aujourd’hui, et plus de langue. Les acteurs, leur légèreté et leur joie, ce qu’on peut trouver sur la scène de distance pour dire les choses terribles, les endroits où l’on peut être ensemble pour panser nos inquiétudes me manquent. Face à l’emprise des images et des folies qui nous guettent, faisons en sorte que nos métiers demeurent des talismans.