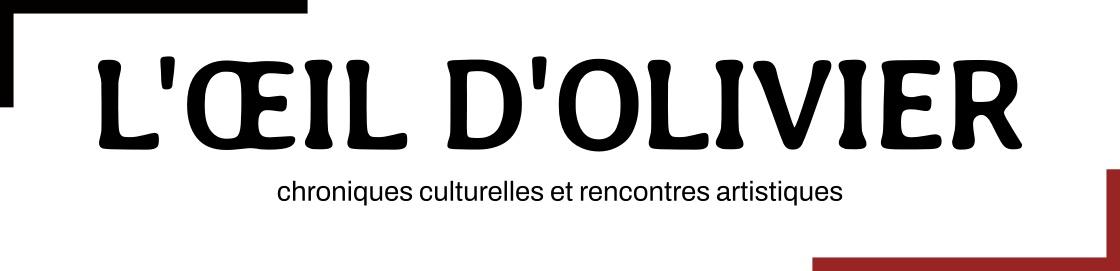Vous souvenez-vous du moment où l’écriture a fait irruption dans votre vie ?
Joëlle Sambi : Oui, très précisément. J’avais une douzaine d’années. J’étais en vacances à Kinshasa, je m’ennuyais ferme, alors j’ai pris un cahier et j’ai commencé à écrire des histoires. Ça m’a tout de suite plu. J’ai enchaîné les temps d’écriture, presque de façon compulsive. J’avais un objectif un peu fou : publier mon premier roman à dix-huit ans. Il y a eu un petit décalage de dix ans… mais l’élan était là.
Plus profondément, je crois que ce besoin vient d’une obsession : laisser une trace. Cette phrase ancrée dans mes racines congolaises, “Quand un vieillard meurt en Afrique, c’est une bibliothèque qui brûle”, m’a toujours bouleversée. Je trouvais cette image terrifiante, perdre autant de savoir, de mémoire, de récits en une seule disparition. Alors, j’essaie, à ma manière, de préserver cette bibliothèque, de l’agrandir, de l’entretenir.
Et de la remplir, sans doute aussi ?
Joëlle Sambi : Remplir, garder, transmettre. C’est peut-être ça l’écriture, en fin de compte. Une tentative de sauver de l’oubli ce qui pourrait disparaître.
Qu’est-ce qui vous pousse aujourd’hui à écrire ?
Joëlle Sambi : Avant même d’être autrice, je suis militante. Féministe, lesbienne, belgo-congolaise. Tous ces éléments façonnent mon regard, ma manière d’être au monde. Ils colorent ce que j’écris, comment je le fais et pour qui. Je pars souvent de ce que je vois autour de moi. Le monde est un matériau inépuisable, : ses tensions, ses injustices, ses fulgurances.
Je n’écris pas de la même façon quand je travaille un poème ou un texte de fiction, mais l’élan initial est souvent le même : une question, une révolte, une envie de dire. En fiction, j’adore croquer des personnages. Il y a là une liberté, un plaisir presque physique. Quant à ma méthode, je suis très intuitive. Je n’ai pas de rituel fixe. J’écris quand ça vient. Parfois, je m’impose une discipline, je m’assieds, j’écris. Mais j’ai besoin d’un espace souple, sans contrainte rigide.
Une forme de liberté intérieure nécessaire ?
Joëlle Sambi : Sans doute. Et c’est aussi une manière de refuser les normes, y compris celles du temps. Je suis très attachée à l’idée de pouvoir aménager mon emploi du temps, de travailler selon mon propre rythme. C’est un luxe que mon métier me permet, et j’en fais une condition de création.
Votre écriture est traversée par cette double appartenance, la Belgique et le Congo. Comment cela vous façonne-t-il ?
Joëlle Sambi : Je me suis toujours sentie “entre”, le cul entre deux chaises, pour reprendre une formule un peu triviale mais très juste. Pleinement Bruxelloise, pleinement Kinoise. Pleinement Congolaise et pleinement Belge. Ce n’est pas une addition, c’est un tiraillement. Une complexité identitaire.
Si j’avais été belgo-malienne ou Malo-congolaise, ce serait peut-être différent. Mais la relation entre la Belgique et le Congo est si singulière, si chargée d’histoire coloniale, de douleurs enfouies, de liens encore à vif. Ce passé empoisonne encore le présent. Dans les deux pays, l’idée même de fierté nationale est difficile à habiter. En Belgique, parce qu’il n’y a pas vraiment de sentiment national fort. Au Congo, la situation politique rend compliqué tout élan de fierté.
Cette tension m’habite, et je crois qu’elle traverse ma langue. Le français que j’écris est traversé par le lingala, par le rythme des corps, par la musique des voix. Par le fait que, parfois, une chanson vaut tous les récits du monde.
Est-ce qu’on écrit différemment en Belgique qu’en France ?
Joëlle Sambi : En France, il y a un rapport très vertical à la littérature. On écrit souvent dans l’ombre de ses “pères”, on se place dans une lignée. Il y a des modèles à suivre, des figures tutélaires. Ce n’est pas du tout le cas en Belgique. Il y a une irrévérence naturelle, une liberté de ton, une autonomie presque insolente. On peut creuser son propre sillon sans devoir forcément se référer à X ou Y.
C’est un terreau fertile. On y expérimente plus facilement. On s’y autorise. Quant au Congo, il y a un rapport au récit très organique. On raconte. On transmet par la parole, par le chant, par le geste. Le récit n’est pas un objet figé. Il est vivant, mouvant, incarné. Dans ma famille, par exemple, on ne racontait pas forcément beaucoup d’histoires, mais on chantait. Et dans ces chants, il y avait déjà tout : les douleurs, les espoirs, les récits.
Dans Faites de feu, vous faites entendre des voix lesbiennes. D’où vient ce désir ?
Joëlle Sambi : Cet impromptu est en effet une dystopie saphique. J’avais envie de créer un espace où les récits lesbiens puissent exister pleinement. Un espace dans lequel le feu — la colère, la passion, l’amour, la sensualité — soit moteur.
Le spectacle part de textes que j’ai écrits à différents moments. Certains anciens, d’autres plus récents. J’ai voulu créer un tableau kaléidoscopique de récits politiques et poétiques, sensuels et engagés. Imaginer un monde où, peut-être, on aurait réussi à brûler les discriminations et les dissoudre dans une forme de lumière.
Comment passe-t-on de l’écriture à la scène ?
Joëlle Sambi : Ce passage est très naturel. Je viens du slam. Dès que j’écris un texte, je sais s’il est destiné à la scène ou à la page. Je l’entends, je le ressens. J’écris souvent à l’oral, dans la musicalité. Je lis mes textes à voix haute, je vérifie qu’ils tiennent debout dans la bouche autant que sur le papier. Si quelque chose sonne faux, je le sais immédiatement. Et parfois, je mets un texte de côté. Il reviendra certainement plus tard, ou pas.
Vous partez donc d’un rythme intérieur ?
Joëlle Sambi : Très souvent, tout commence par une phrase qui me tourne dans la tête, en boucle. Elle s’impose. Elle dicte un rythme. Quand ça arrive, je sais que je dois l’écrire, et vite. C’est presque une transe douce, une injonction intérieure. Le rythme est là avant même les mots. C’est lui qui décide.
Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
Gaites de feu de Joëlle Sambi
MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris
du 2 au 3 mai 2025
durée 40 min