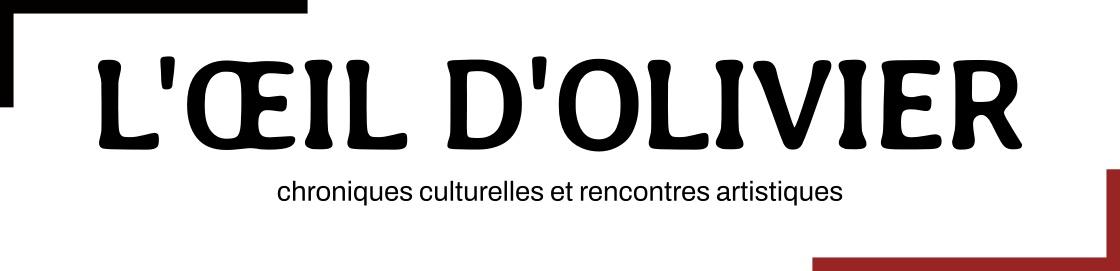Son long manteau dissimule une chemise noire ornée de fleurs. Les cheveux encore humides et brossés vers l’arrière, il jette un rapide coup d’œil au ciel grisâtre qui recouvre Montpellier en ce mois de février. Nicolas Maury semble prendre acte que le soleil n’est pas au rendez-vous cette fois-ci. Mais son regard est irrépressiblement attiré vers le ciel, comme en quête d’un rayon lumineux qui ne peut que finir par se montrer. Après tout, il connaît la ville, pour y avoir joué à plusieurs reprises, à La Vignette avec Steve Jobs ou au Printemps des Comédiens avec une lecture autour de Marguerite Duras. Et puis il connaît l’été héraultais, plus précisément celui de Pézenas, où il passe régulièrement du temps avec son acolyte de vingt ans – le chiffre lui donne le tournis –, Robert Cantarella. C’est précisément à ses côtés qu’il remet les pieds au Théâtre des 13 vents, pour les dernières dates de la saison d’Un prince de Hombourg.
La veille, la première des trois représentations montpelliéraines a eu lieu. L’expérience lui laisse déjà un souvenir heureux. Il avait positivement gardé en mémoire le lieu depuis son passage en 2013 avec La nuit tombe… de Guillaume Vincent. Or voici que la salle comble, la jeunesse et la curiosité des spectateurs du CDN l’émerveillent encore davantage, douze ans plus tard. Cette attention envers le public n’a rien d’anodin. À plusieurs reprises, il évoque, comme des paroles précieuses, les discussions qu’il a eues en sortie de salle. Ce lien, ce rapport au spectateur, l’anime au plateau autant qu’il lui est essentiel en-dehors.
Rêver les yeux ouverts

Avant ce projet, Nicolas Maury ne connaissait de Kleist que Michael Kohlhaas. Le Prince de Hombourg lui était vaguement apparu, au détour d’un enregistrement issu de la création de Jean Vilar au Festival d’Avignon 1951 avec Gérard Philipe dans le rôle-titre. Mais il retient surtout de ces archives la voix de Jeanne Moreau, incarnant le personnage de la jeune Natalie. « J’aime écouter des documents comme ça, Laurence Olivier, Sarah Bernhardt, Colette… J’adore cet endroit-là de l’oralité, de la voix, de la formulation. »
Pourtant lorsqu’il s’agit d’évoquer son rapport au rêve, Nicolas Maury semble se lier d’évidence au personnage écrit par Kleist : « Pour moi, tout part de la chambre, du lit. Quand on décide d’avoir un chemin d’artiste, c’est parce qu’on a voyagé dans sa chambre, de façon immobile. Quand j’étais enfant, je m’endormais dans des clapiers, dans des armoires, et je rêvais, je crois. Il y a cette idée de sommeil, cet endroit où j’abolis la frontière nette entre être éveillé et endormi ». La ressemblance reste toutefois anecdotique, « un instinct » de Robert Cantarella, tout au plus. Car en ce qui concerne la matérialisation du rêve sur un plateau, le concret prend rapidement le dessus : « L’onirisme, ça peut faire passer des vessies pour des lanternes. Mais c’est plus compliqué que ça, la peau des rêves. Lynch, qui est parti, était un génie artisanal du rêve. Ça pourrait être ça, la définition de la mise en scène ».
Fragile comme une chimie

Il faut dire que sur la question de la mise en scène, l’artiste n’est pas en reste. Ses années de conservatoire lui ont permis d’en aborder la pratique en même temps que Pauline Bureau, même si leurs chemins ont ensuite pris des directions différentes. Et il a depuis, à maintes reprises, eu l’occasion d’en expérimenter différentes formes, du théâtre à la lecture en passant par le cinéma. Il est d’ailleurs en ce moment-même sur le montage d’une série (Les Saisons) qu’il réalise pour Arte et HBO. Mais tandis qu’il accepte avec enthousiasme les propositions de jeu qui lui sont faites, c’est autant de temps que Nicolas Maury ne consacre pas à d’autres projets personnels. « J’ai beaucoup de désir », assure-t-il néanmoins, d’autant qu’il donne à la mise en scène une place essentielle : « Je fais partie de ces gens qui aiment vraiment les metteurs en scène. J’ai été élevé comme ça, j’ai toujours aimé cette verticalité-là, ce regard ».
À l’instar de son partenariat de longue durée avec Robert Cantarella, les collaborations avec Guillaume Vincent, Muriel Mayette-Holtz ou Galin Stoev qui jalonnent son parcours en sont la preuve. « Je ne suis pas forcément très sympathique dans le travail », reconnaît-il d’ailleurs en réponse à la confiance renouvelée qui lui est alors témoignée, avant de poursuivre : « C’est pas sympa, le travail. C’est pas payant, les répétitions, c’est rarement beau à voir. Tel que je le prends, c’est rarement réussi. Par contre, j’adore rater en répétition. J’adore tomber, là où les gens disent qu’il ne faudrait pas tomber. Je trouve ça ridicule, il faut toujours tomber ». Alors la nature même d’une association réussie tient probablement à une approche similaire du travail, comme avec Robert Cantarella : « Pour lui, la mise en scène est un acte citoyen, civique. Mettre en scène, ce n’est pas mentir, c’est entretenir. J’aime bien ce terme d’entretien ».
Cette manière d’aborder les choses apporte malgré tout son lot d’incertitudes : « Je ne prends pas ça comme un rendez-vous obligé, que les gens soient dans la salle. Quand c’est le cas, je suis en gratitude ». Je lui fais remarquer que dans son discours, la pratique du théâtre semble alors particulièrement fragile, mais l’image est plus précise encore : « Oui, mais fragile comme une chimie, pas quelque chose qui va s’effondrer. Je dis souvent que le théâtre, c’est ma maison qui brûle. C’est l’art le plus austère et le plus magnifique ».
Désir et ennui

Afin de mesurer l’intensité avec laquelle Nicolas Maury parle de théâtre, il faut comme souvent revenir aux premières fois. Or les premières fois, quand on grandit dans un village du Limousin, cela ne va pas de soi. Dans ses souvenirs, l’artiste évoque des « chocs » et des « passeurs », quelque chose de l’ordre de la rencontre, de la confrontation. Il prend, pour illustrer son propos, l’exemple d’une jeune femme de la veille venue « voir le mec de Dix pour cent« et en sortir déstabilisée dans ses attentes, qu’importe l’éloge ou la critique. Il y a de cela, chez lui, qui convoque comme des amis Sarah Kane, Marguerite Duras ou Stig Dagerman : un désir permanent de poésie qui se traduit aussi dans ses choix artistiques… Mais pas à n’importe quelle condition.
S’il y a un prix que Nicolas Maury refuse de payer, c’est en effet celui de l’ennui : « Je fais des choses que j’adore. Mais dès que c’est trop ergonomique, je pense au théâtre et il m’aide à ne pas m’endormir, à rester rêveur ». La formule n’a malheureusement rien d’imparable, il lui est aussi arrivé de s’ennuyer sur un plateau jusqu’à devoir se retirer d’un projet. Mais contre l’homogénéité, le spectacle vivant reste à l’endroit d’une passion viscérale : « Je tiens au théâtre. C’est quelque chose qui m’a sauvé la vie et je ne peux pas le faire par-dessus la jambe ».
C’est animé de toute cette conviction qu’il appréhende chacune des représentations, dans une dynamique de travail perpétuel : « La vraie recherche doit être quand on joue. Elle doit être sur des ruines, aussi. Je trouve que c’est sensuel et sexy ». Pour lui, l’arrivée dans un théâtre, en tournée, est aussi synonyme de (re)création, tant le spectacle doit s’adapter à son nouveau lieu d’accueil et, on l’entend plus rarement, au public présent d’un soir sur l’autre. Alors la sensibilité et la sincérité de l’acteur dans son rapport à la scène touchent-elles presque au sacré. Et Nicolas Maury de citer Isabelle Huppert citant Grotowski : « Il y a ce qui est évidemment nécessaire, urgent, vital plus que jamais, de ne pas nommer ».
Les pieds sur terre

Il a beau s’entourer de toute la poésie et de tous les songes du monde, Nicolas Maury n’en est pas pour autant déconnecté de toute réalité, notamment en ce qui concerne l’économie de son secteur. Et pour cause, il ne fait pas partie de ces artistes à qui tout a été offert sans effort. Depuis ses premiers projets jusqu’à maintenant, il n’a pas expérimenté d’autre politique que l’austérité en matière culturelle : « Je n’ai pas connu d’époque où l’argent coulait à flot ». Voilà qui forge et l’homme et le discours : « J’ai privilégié, sans sacrifice évidemment, par amour de la beauté, de l’acte, une certaine forme de communisme culturel, d’emmener les formes les plus pointues dans des villages. Ne jamais penser « à la place de ». La fameuse place du spectateur n’existe pas. Il faut amener le théâtre, je veux bien jouer partout, je croirai toujours au déplacement individuel de l’être humain ».
Seulement, pour cela et pour qu’ait lieu une création, la question de l’argent est bien réelle. Et à ce sujet, c’est encore une vision très personnelle dont il me fait part : « Il y a aussi un art qui est celui de la production. On n’en parle pas, mais ça peut être un art. En tout cas, un endroit de pensée ». Au théâtre, artistes et producteurs sont souvent à part l’un de l’autre, mais son expérience du cinéma apporte un autre regard : « L’acte de mise en scène d’un cinéaste intègre commence dès la production ». La manière dont il se remémore les prémices d’Un prince de Hombourg en témoigne : « Chaque été, on va dans la bibliothèque de Robert et on lit des livres à voix haute, comme on a fait avec Kleist. Il est tombé, on l’a ramassé, on était face à la rivière, avec du vent. On aurait dit une mise en scène de Castellucci. On aurait dit qu’une tragédie allait arriver, et puis je lisais. Il y a eu du soleil, de la pluie, de l’orage. C’était le premier acte, et la mise en scène était déjà là ».
Nos cafés terminés, Nicolas Maury doit bientôt rejoindre le théâtre en préparation de sa prochaine représentation. Je lui demande ce qu’on peut lui souhaiter, sa réponse m’étonne autant qu’elle est finalement sensée : « Une maison ». « Quelque chose de matériel ? », ne puis-je m’empêcher de préciser. Et lui de me rétorquer avec tout son naturel souriant : « Oui, quoi d’autre ? ». Il semblait oublier que son Prince de Hombourg se terminait sur ces mots affichés à l’écran : « Un rêve, quoi d’autre ? »…
Peter Avondo
Un prince de Hombourg d’après Heinrich von Kleist
Création le 6 décembre 2023 Au théâtre de Vidy-Lausanne
Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier
Du 11 au 13 février 2025
Durée 2h20 environ
Traduction et adaptation de Stéphane Bouquet
Mise en scène de Robert Cantarella
Avec Nicolas Maury, Charlotte Clamens, Christian Geoffroy Schittler,
Jean-Louis Coulloc’h, Bénédicte Amsler Denogent, Martin Reinartz
Assistanat – Anouk Werro
Scénographie de Sylvie Kleiber
Lumière de Philippe Gladieux
Musique d’Alexandre Meyer
Costumes de Constance de Corbière, Nadine Moec
Régie – Soleiman Chauchat