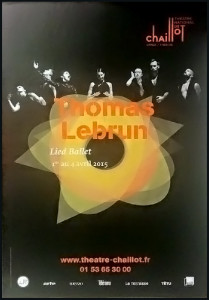La nouvelle création de Thomas Lebrun peut, au premier regard, sembler âpre, déconcertante, hermétique, pesante et absconse. Ce n’est qu’une impression fugace. Très vite, le jeu d’ombres fascinant, les mouvements mécaniques et la virtuosité des danseurs, nous entraînent dans un ballet, certes très singulier, mais d’une rare beauté. S’inspirant du romantisme allemand du XIXe siècle, le chorégraphe écrit ici, avec épure et un brin de mélancolie, l’histoire de la danse contemporaine. Terriblement troublant.
L’argument : Lied Ballet du chorégraphe Thomas Lebrun s’annonce comme une réflexion sur les codes du ballet. Considérant le plaisir de danser comme moteur de la création, Thomas Lebrun fait de son spectacle une variation virtuose.
Lied Ballet est une pièce d’aujourd’hui qui croise deux formes majeures de l’époque romantique : l’une chorégraphiée, l’autre musicale.
Utilisant les textes des lieder comme livret et comme source première de l’écriture chorégraphique, cette création pose ses empreintes sur les courants du passé, flirtant avec la composition narrative ou formelle du ballet, se glissant dans les mélodieuses thématiques chères au romantisme… La mort, l’amour, la nature, l’errance, la solitude, sont autant de points communs entre ces deux formes qui ont toutefois connu un parcours inversé.
La critique : La danse est une mécanique du corps et du mouvement. Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique national de Tours, l’a bien compris. Dans son Lied Ballet, inspiré des poèmes germaniques dont il porte le nom, chantés par une voix, accompagnés ici par un piano, il s’intéresse à l’histoire de la danse contemporaine, s’interroge sur son évolution dans le temps, et se captive pour les différents modes d’interprétations qui y sont liés. Construit en trois parties comme tout ballet classique à la française, Lied Ballet, qui a fait les beaux jours du Festival In d’Avignon l’été dernier, est surtout une émanation moderne du romantisme allemand du XIXe siècle. On y reconnaît la patte de Goethe ou de Schiller, leur regard nostalgique sur la vie, et leurs principales thématiques : la mort, l’amour, la perte, le cri et la solitude. Cette acuité sur l’essence de son travail et sur celui des autres chorégraphes prend corps grâce à huit danseurs, huit virtuoses du mouvements.
Cherchant l’épure, que ce soit dans la scénographie ou la chorégraphie, le décor est réduit à son plus simple appareil : des murs noirs, un sol blanc immaculé. Un couple de danseurs, visages pâles et fermés, vêtus de noir, corps tendus à l’extrême, ouvre ce bal sombre. Tels deux corbeaux, deux âmes noires, errantes, ils se tiennent la main, unissant un temps leurs destinées. Mais très vite, les sons stridents des violons jouant Chukrum de Giancinto Scelsi cassent cette harmonie froide. Cinq autres danseurs les rejoignent. Tous habillés de noir, que ce soit en robe du soir, soulignant la silhouette élancée de l’une, soit en juste-au-corps de dentelle, rappelant les tenues victoriennes, soit en chemises longues de lin transparent, donnant une fluidité vaporeuse et élégante aux corps hétéroclites des artistes. La famille enfin réunie, le premier acte de ce ballet étrange et hypnotique peut commencer. Les mouvements sont précis, nets, saccadés et mécaniques. Evoluant en groupe, semblable à un vol d’oiseaux, les danseurs se déplacent d’un pas rapide d’un coin à l’autre de la scène avant de se figer, de prendre un temps la pause, ou d’exécuter des gestes géométriques, des pantomimes. Chacun sa posture, chacun sa grimace, chacun son rôle dans ces tableaux stylisés et maniérés représentant tour à tour la mort, l’abandon, le rejet, l’amour ou la perte. Parfois, pour accentuer la poésie et la pureté des mouvements, les danseurs, dont l’équilibre semble quelquefois au bord de la rupture, leurs corps attirés par la pesanteur, psalmodient en chœur des sortes de mélopées mélancoliques.
Cet ensemble très codé est renforcé par les jeux d’ombres qui s’opèrent grâce à un éclairage judicieux. C’est époustouflant, d’une beauté insolite et rare. Pour renforcer cette étrangeté lugubre et inquiétante, apparaît un étrange oiseau : un danseur dégingandé, au corps malléable. D’un pas lent, assuré, il traverse l’espace de part en part. Ses mouvements, à l’unisson de la musique, rythment le deuxième acte. Les visages s’ouvrent, le noir fait place à l’ivoire, les corps s’élancent, plus légers, plus vivants. Solos, pas de deux, pas de trois, toutes les figures élémentaires des ballets traditionnels sont représentées, mais décortiquées, décomposées, pour n’en garder que l’essence : le mouvement pur, le geste précis. A l’arrière plan, à côté du piano où s’est installé Thomas Besnard, le jeune ténor Benjamin Alunni entonne de sa voix claire, douce, les plus beaux Lieder d’Alban Berg, Gustav Mahler ou Arnold Schönberg. La puissance des textes, servie par la tessiture profonde du chanteur, envahit l’espace et offre aux danseurs un nouveau souffle plus souple, plus humain. Plus émouvante, cette deuxième partie est parfois pesante mais garde une grâce, une élégance subtile et magique.
La salle s’obscurcit. Les artistes disparaissent. Le spectacle touche à sa fin. C’est sans compter l’esprit malicieux et facétieux de Thomas Lebrun. Un son sourd s’élève. C’est l’œuvre étonnante du compositeur contemporain David François Moreau. Les costumes disparaissent et sont remplacés par d’étranges maillots unisexe bleu-canard, qui n’avantagent clairement pas les corps des danseurs, qu’ils soient élancés ou musculeux. L’individualisme n’est plus, place à la solidarité, au chorus. A l’unisson, dans une marche frénétique et des mouvements plus rythmés, mimant ceux de la natation synchronisée, nos artistes semblent piégés, incapables de sortir de cette boucle infinie. Le romantisme a fait long feu, il est remplacé par un modernisme plus froid, implacable, où chacun est imbriqué dans un tout, unique. Etonnement, cette dernière partie est certainement la plus accessible, la plus enlevée… Elle finit de nous convaincre… Ce ballet, si étrange qu’il soit, est d’une rare beauté.
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore
Lied Ballet de Thomas Le brun
Durée : 70 minutes
Au Théâtre national de Chaillot jusqu’au 4 avril 2015 0
Au Pavillon noir à Aix-en-Provence du 21 au 22 avril 2015
A l’Art festival de Macao en Chine je 1er avril 2015
A La Rampe, scène conventionnée d’Echirolles le 05 avril 2015
A la scène national d’Orléans le 27 avril 2015
Chorégraphie : Thomas Lebrun
Interprétation : Maxime Camo, Anthony Cazaux, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Tatiana Julien, Anne-Sophie Lancelin, Matthieu Patarozzi, Léa Scher
Chant : Benjamin Alunni, ténor
Piano : Thomas Besnard
Musiques : Giacinto Scelsi, Alban Berg, Gustav Mahler, Arnold Schönberg
Création musicale : David François Moreau
Création costumes : Jeanne Guellaff
Création lumière : Jean-Marc Serre
Création son : Mélodie Souquet
Réalisation costumes : Jeanne Guellaff, Sylvie Ryser
Crédit photos © Frédéric Iovino